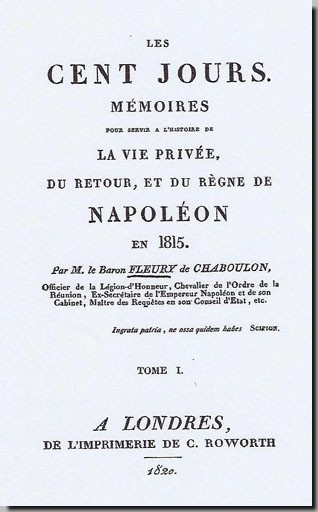Tome I
p.344-345
M le Baron de Vincent se refusa d’abord à toute espèce de communication et de pourparlers ; mais il consentit ensuite à se trouver avec M de Vicence dans une maison tierce. Ils eurent ensemble une conférence chez Mme de Souza. M de Vincent ne dissimula point la résolution des alliés de s’opposer à ce que Napoléon conservât son trône. mais il fit entrevoir qu’il pensait que son fils n’inspirerait point la même répugnance. Il s’engagea néanmoins à faire connaître à l’Empereur d’Autriche les sentimens de Napoléon ; et consentit à se charger d’une lettre pour l’impératrice Marie-Louise.
Tome 2
p.72
Il tenta d’abord, par pusieurs lettres pleines de sentimens et de dignité, d’émouvoir la justice et la sensibilité de l’Empereur d’Autriche. Les réclamations, les prières étant restées sans effet, il résolut de charger un officier de la couronne de se rendre à Vienne, pour négocier ou requérir publiquement, au nom de la nature et du droit des gens, la délivrance de l’Impératrice et de son fils. Il confia cette mission à M le comte de Flahaut l’un de ses aides-de-camp. Personne n’était plus en état que cet officier, de la remplir dignement. C’était un véritable Français : spirituel, aimable et brave, il était aussi brillant sur un champ de bataille, que dans une conférence diplomatique ou dans un salon, et savait plaire en tous lieux par l’agrément et la fermeté de son caractère.
M de Flahaut partit, et ne put dépasser Stuttgard. Cette disgrâce convertit en regret douloureux la joie qu’avait déjà fait naître l’espérance de revoir le jeune prince et son auguste mère.
p.184
Il les fait former en carré, et s’avance à leur tête au devant de l’ennemi ; tous ses généraux, Ney, Soult, Bertrand, Drouot, Corbineau, de Flahaut, Labédoyère, Gourgaud, etc., mettent l’épée à la main et deviennent soldats. Les vieux grenadiers, incapables de trembler pour leur vie, s’effrayent du danger qui menace celle de l’Empereur…
p.193-194
La suite de l’Empereur fut refermée dans deux autres calèches ; l’une, dans laquelle je me trouvais, contenait M de Bassano, le général Drouot, le général Dejean et M de Canisy, premier écuyer ; l’autre était occupée par MM de Flahaut, Labédoyère, Corbineau, et de Bissi, aides-de-camp.
L’Empereur s’arrêta au delà de Rocroi pour prendre quelque nourriture. Nous étions tous dans un état à faire pitié ; nos yeux gonflés par les larmes, nos figures décomposées, nos habits couverts de sang et de poussière nous rendaient pour nous-mêmes un objet de compassion et d’horreur. Nous nous entretînmes de la crise où allait se trouver l’Empereur et la France. Labédoyère, plein de la candeur que donne un coeur jeune et inexpérimenté, se persuadait que nos dangers rallieraient tous les partis, et que les chambres déploieraient une grande et bienfaisante énergie. « Il faut, disait-il, que l’Empereur, sans s’arrêter en route, se rende directement dans le sein de la représentation nationale, qu’il avoue franchement ses malheurs, et que (comme Philippe-Auguste) il offre de mourir en soldat et de remettre la couronne au plus digne. Les deux chambres se révolteront à l’idée d’abandonner Napoléon, et se réuniront à lui, pour sauver la France. » – Ne croyez point, lui répondis-je, que nous soyons encore dans ces tems où le malheur était sacré. La chambre, loin de plaindre Napoléon et de venir généreusement à son secours, l’accusera d’avoir perdu la France, et voudra la sauver en la sacrifiant. » – « Que Dieu nous préseve d’un semblable malheur ! s’écria Labédoyère ; si les chambres s’isolent de l’Empereur, tout est perdu. Les ennemis, sous huit jours, seront à Paris. Le neuvième nous reverrons les Bourbons ; alors que deviendra la liberté et tous ceux qui ont embrassé la cause nationale ? Quant à moi, mon sort ne sera point douteux. Je serai fusillé le premier. » – « L’Empereur est un homme perdu, s’il met le pied à Paris : il n’a qu’un seul moyen de se sauver, lui et la France, reprit M de Flahaut ; c’est de traiter avec les alliés et de céder la couronne à son fils. Mais pour pouvoir traiter, il faut qu’il ait une armée ; et peut-être au moment où nous parlons, la plupart des généraux songent-ils déjà à envoyer leurs soumissions au Roi. » (M de Flahaut voyait juste, car il paraît certain que le maréchal Grouchy avait eu des pour-parlers avec les alliés, et qu’un arrangement, à la manière du duc de Raguse, allait être signé, lorsque le général Excelmans fit arrêter le colonel Prussien envoyé au maréchal pour conclure le traité déjà convenu.) – « Raison de plus, dit Labédoyère, pour se hâter de faire cause commune avec les chambres et la nation, et pour se mettre en route sans perdre de tems. » – « Et moi, répliquais-je, je soutiens, comme M de Flahaut, que si l’Empereur met le pied à Paris, il es perdu. On ne lui a jamais pardonné d’avoir abandonné son armée en Egypte, en Espagne, à Moscow. On lui pardonnera bien moins encore de l’avoir laissée là, au centre de la France? »
Ces diverses opinions, approuvées ou condamnées, servaient d’aliment à nos discussions, lorsqu’on vint nous avertir que les Anglais étaient à la Capelle (Cet avis était faux), à quatre ou cinq lieues de nous. On en prévint sur-le-champ le général Bertrand. Mais l’Empereur continua de causer avec le duc de Bassano, et nous eûmes mille peines à lui faire reprendre la route.
Nous arrivâmes à Laon ; l’Empereur descendit au pied de la ville. On connaissait déjà notre défaite. Un détachement de la garde nationale vint au-devant de l’Empereur. « Nos frère et nos enfans, lui dit l’officier-commandant, sont dans les places fortes, mais disposez de nous, Sire ; nous sommes prêts à mourir pour la patrie et pour vous. » L’Empereur le remercia vivement. Quelques paysans nous entouraient et nous regardaient stupidement ; souvent ils criaient vive l’Empereur ! ces cris nous faisaient mal. Ils plaisent dans la prospérité ; après une bataille perdue, ils déchirent le coeur.
p.200
Je lus ce nouveau vingt-neuvième bulletin ; quelques légers changemens, proposés par le général Drouot, furent agréés par l’Empereur ; mais, je ne sais par quelle bizarrerie, il ne voulait point avouer que ses voitures étaient tombées au pouvoir de l’ennemi : « Quand vous traverserez Paris, lui dit M de Flahaut, on s’apercevra bien que vos voitures ont été prises. Si vous le cachez, on vous accusera de déguiser des vérités plus importantes ; et il faut ne rien dire, ou dire tout. » L’Empereur, après quelques façons, finit par accéder à cet avis.
je fis alors une seconde lecture du bulletin, et tout le monde étant d’accord de son exactitude, M de Bassano l’expédia au prince Joseph, par un courrier extraordinaire.
p.266
Napoléon était donc resté presque seul, à la Malmaison. (Sa cour, jadis si nombreuse, n’était plus habituellement composée que du duc de Bassano, du comte de Lavalette, du général Flahaut, et des personnes qui devaient partir avec lui, telles que ses officiers d’ordonnance, le général Gourgaud, les comtes de Montholon, de Lascases, et le duc de Rovigo.)
p.270
La proposition de Napoléon fut bientôt connue de tout Paris ; on commença par publier qu’il avait voulu reprendre le commandement ; on finit par annoncer qu’il l’avait repris. Napoléon en effet, aussitôt le départ du général Beker, fit seller ses chevaux de bataille ; et pendant trois heures, on crut qu’il allait se rendre à l’armée. Mais il ne songea point à profiter lâchement de l’absence de son gardien pour s’évader. Une telle pensée était au-dessous de l’homme qui venait d’attaquer et d’envahir un royame avec huit cents soldats.
Le général Beker revint à la Malmaison. L’Empereur se saisit de la réponse de la commission, la parcourut rapidement, et s’écria : « J’en étais sûr ; ces gens-là n’ont point d’énergie ; eh bien, général, puisque c’est ainsi, partons, partons. » Il fit appeler M de Flahaut et le chargea d’aller à Paris, sur-le-champ, concerter son départ et son embarquement avec les membres de la commission.
Le prince d’Eckmuhl se trouvait aux Tuileries, au moment où M de Flahaut s’y présenta. Il ne vit dans la mission de ce général qu’un subterfuge de l’Empereur, pour différer son départ. « Votre Bonaparte, lui dit-il avec le ton de la colère et du mépris, ne veut point partir, mais il faudra bien qu’il nous débarrasse de lui ; sa présence nous gêne, nous importune ; elle nuit aux succès de nos négociations. S’il espère que nous le reprendrons, il se trompe ; nous ne voulons plus de lui. Dites-lui de ma part qu’il faut qu’il s’en aille, et que s’il ne part à l’instant, je le ferai arrêter, que je l’arrêterai moi-même. » M de Flahaut, enflammé d’indignation, lui répondit : « Je n’aurai jamais pu croire, M le Maréchal, qu’un homme qui, il y a huit jours, était aux genoux de Napoléon, pût tenir aujourd’hui un semblable langage. Je me respecte trop, je respecte trop la personne et l’infortune de l’Empereur, pour lui reporter vos paroles ; allez-y vous-même, M le Maréchal ; cela vous convient mieux qu’à moi. » – Le prince d’Eckmuhl, irrité, lui rappela qu’il parlait au ministre de la guerre, au général en chef de l’armée, et lui prescrivit de se rendre à Fontainebleau où il recevrait ses ordres. – « Non, monsieur, reprit vivement le comte de Flahaut, je n’irai point ; je n’abandonnerai point l’Empereur ; je lui garderai jusqu’au dernier moment la fidélité que tant d’autres lui ont jurée. » – « Je vous ferai punir de votre désobéissance ! » – « Vous n’en avez plus le droit. Dès ce moment je donne ma démission. Je ne pourrais plus servir sous vos ordres sans déshonorer mes épaulettes. »
Il sortit. L’Empereur à son retour s’aperçut qu’il avait l’âme blessée ; il le questionna, et parvint à lui faire avouer ce qui s’était passé. Habitué, depuis son abdication, à ne s’étonner de rien et à tout souffrir sans se plaindre, Napoléon ne parut ni surpris ni mécontent des insultes de son ancien ministre. « Qu’il vienne, répondit-il froidement, je suis prêt, s’il le veut, à lui tendre la gorge. Votre conduite, mon cher Flahaut, ajouta-t-il, me touche ; mais la patrie a besoin de vous : restez à l’armée ; et oubliez, comme moi, le prince d’Eckmuhl et ses lâches menaces. »
L’histoire plus sévère ne les oubliera point. Le respect pour le malheur fut toujours placé au premier rang des vertus militaires. Si le guerrier qui outrage son ennemi désarmé perd l’estime des braves, quel sentiment doit-il inspirer celui qui maudit, insulte et menace son ami, son bienfaiteur, son prince malheureux ?
SORT DES PERSONNES QUI FIGURENT DANS CES MEMOIRES.
M le Baron Quinette, banni, rappelé.
M Thibaudeau, proscrit.
Le général Béker, pair de France.
Le général Flahaut, naturalisé anglais.
M de Tromeling, maréchal de camp en activité.
L’auteur des mémoires, indépendant.
Fin du deuxième et dernier Volume.