Gouverneur Morris : un témoin américain de la Révolution française
commentaire de l’ouvrage de A. Esmein (Paris, Hachette, 1906, in-16 de 386 p.)
par L. de N.
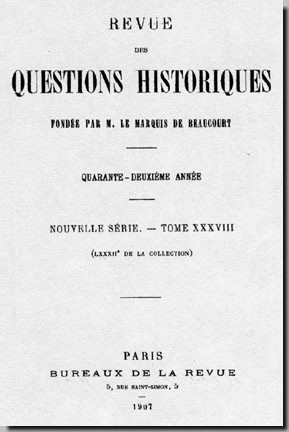
Gouverneur Morris : un témoin américain de la Révolution française, par A. Esmein. Paris, Hachette, 1906, in-16 de 386 p.
Gouverneur Morris n’est pas un inconnu pour le public français. Un volumineux journal et une correspondance très étendue, après avoir fourni d’intéressants extraits à une biographie publiée à Boston, par Sparks, en 1832, traduite dix ans après en français par M. Gandais, ont été édités d’une manière plus sérieuse, en 1888, par une petite-fille de l’auteur, Miss A. C. Morris, en deux volumes in-8 de 600 pages chacun. Il n’en existe malheureusement pas de traduction française complète, M. Parisot (Pariset ?) ayant réduit à environ un tiers celle qu’il a donnée (Paris, Plon, 1901, in-8 de 334 p.) Malheureusement aussi, Miss Morris a cru devoir pratiquer de larges retranchements dans l’oeuvre de son aïeul. C’est son édition sur laquelle M. Esmein a entrepris de nous faire connaître les idées politiques de Morris par de très intéressants extraits ; il y joint ceux de publicistes d’opinions analogues, tels que Mallet-Dupan, Malouet, Moreau et Morellet, auxquels il ajoute assez discrètement ses propres réflexions.
Après avoir joué un rôle marquant, mais empreint d’un caractère avéré de prudence et de modération, dans la révolution d’Amérique, Morris débarqua en France en janvier 1789, sans mission officielle, et dans le seul but de servir des intérêts financiers et commerciaux, qui étaient en partie ceux d’un certain nombre de ses compatriotes. Doué d’amabilité et d’un esprit original, il fut accueilli avec empressement dans la société la plus élégante, dont il goûtait largement tous les charmes. Mais bientôt allait se dérouler sous ses yeux un spectacle auquel il était mal préparé. Il n’y avait rien de commun entre ses sentiments et ceux des Français de 1789. Ami sincère de la liberté, non seulement de la sienne, mais de celle des autres, Morris n’avait que de la répugnance pour tout ce qui était subversion. En fait de théories politiques, il ne connaissait que celles de Montesquieu, alors oubliées en France pour celles de l’abbé Mably dans les classes privilégiées, pour celles de Jean-Jacques Rousseau chez les démocrates. Tout républicain qu’il était, il aurait voulu voir respecter non seulement l’autorité royale, mais jusqu’à l’existence des deux premiers ordres. Quand paraît l’ordonnance du 23 juin, il ne lui reproche que de se produire trop tard, sans approfondir si elle eût obtenu du succès six semaines plus tôt.
Ce qui n’empêche qu’au 14 juillet, il applaudit dans une lettre à la lutte contre la tyrannie, bien que celle-là ne se promit à coup sûr rien de plus que la réalisation de ses propres idées. Mais Morris, homme essentiellement prudent et circonspect, veillait avec le plus grand soin à ne jamais se trouver compromis. Il est permis de supposer que cette préoccupation ne fut pas étrangère à son départ pour Londres, en août 1789, et plus tard en 1791, au moment où allait avoir lieu le voyage de Varennes.
Ses sentiments favorables à la royauté, les prévisions sinistres dont il n’avait pas fait mystère et dont la réalisation avait mis en lumière sa clairvoyance, lui avaient donné la réputation d’un politique habile et la confiance de plusieurs conseillers de Louis XVI. Ses rapports avec le comte de Montmorin furent fréquents et prolongés. Il fut souvent consulté, mais sans grand profit ; il se bornait à dire ce qu’il aurait fallu faire, en ajoutant que ce n’était plus le moment. Il semble qu’il se soit agi un instant de le faire entrer dans le ministère, mais ce n’était pas un homme à embrasser une carrière aussi périlleuse.
Dans les premiers mois de son séjour en France, Morris s’était fait l’ami intime de Talleyrand, alors évêque d’Autun et de Mme de Flahaut, depuis de Souza, qui entretenaient une liaison beaucoup moins qu’édifiante. Peut-être le soin de ses intérêts pécuniaires avait-il conduit l’Américain dans ce milieu, où l’on s’occupait d’intrigues de toutes sortes. Plus tard, il y fut le confident d’un projet politique tendant à donner la direction des affaires à Talleyrand s’unissant à Lafayette. Mme de Flahaut entrait dans ce plan, mais elle exigeait un pot-de-vin d’un million pour sa part de prise (p. 175). Morris trouvait Lafayette et Talleyrand acceptables pour le roi, mais il n’admettait pas qu’on pût traiter avec Mirabeau. La suite devait montrer combien toutes les négociations ouvertes avec les hommes de la Révolution ne pouvaient aboutir qu’à des résultats dérisoires. Avec Mirabeau ou avec Sieyès, avec Talleyrand ou avec Lafayette, avec Lameth ou avec Barnave, avec Brissot ou avec Danton, on s’entendait facilement tant qu’il n’était question que des forts prélèvements d’argent qui épuisaient les ressources de la liste civile. Mais on exigeait ensuite que Louis XVI s’associât pleinement à toute l’oeuvre de la Révolution, y compris et surtout à la guerre au catholicisme, inaugurée sous le prétexte que la constitution donnée au clergé était une partie intégrante et essentielle de la constitution française. On voulait donc forcer le malheureux roi, qui ne pouvait s’empêcher d’être un croyant, à abjurer les sentiments de la conscience et de l’honneur, que ses adversaires étaient incapables de comprendre.
En avril ou mai 1792, Morris fut nommé ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris, emploi qu’il accepta sans enthousiaisme, et qu’il conserva néanmoins jusqu’en octobre 1794, où il quitta la France pour n’y plus revenir. Depuis le 10 août, il avait sagement suspendu la rédaction de son journal, qu’il reprit quand il se vit en lieu de sûreté. Les dépêches destinées à l’Amérique donnent seules quelque idée de ses impressions pendant la Terreur. Il resta en Europe jusque vers la fin de 1798, tantôt en Angleterre, tantôt en Allemagne. Ses jugements sur la France n’offrent plus le même intérêt. Il prévoyait depuis longtemps que le rôle dominateur de l’armée y amènerait la création d’un régime despotique ; mais ce n’était point là un trait de rare divination. Il salua avec bonheur le retour de la monarchie légitime en 1814, et mourut dans ses foyers le 16 novembre 1816.
Le petit volume publié par M. Esmein est d’une lecture attachante, grâce à l’abondance des extraits et citations bien choisies qu’il y a fait entrer. Mais nous ne pouvons nous dispenser de remarquer qu’on y trouverait plus d’agrément s’il y régnait un peu plus d’ordre. Sans doute, la matière des divers chapitres est disposée suivant leur succession chronologique. Mais dans le détail des citations, l’auteur s’écarte à chaque instant d’un plan si naturel et si nécessaire. Sommes-nous en 1789, il nous donne des passages du journal ou des lettres sous la date de 1792, ou même de la période du Directoire. Arrivés à 1792, nous voyons revenir des extraits de ce que Morris avait écrit en 1789. L’attention du lecteur en est quelquefois fatiguée, et il ne peut se rendre un compte aussi exact des sentiments du judicieux Américain dans les diverses circonstances. Faut-il ajouter que les fautes d’impression sont par trop nombreuses dans ce volume ? Il y a lieu de s’étonner que M. Esmein, et même la maison Hachette, l’aient livré au public sans avoir suffisamment pourvu à la correction des épreuves. Enfin, il est fort regrettable qu’une table des noms ne termine pas cet ouvrage, qui en serait plus utile et plus facile à consulter.
L. de N.
