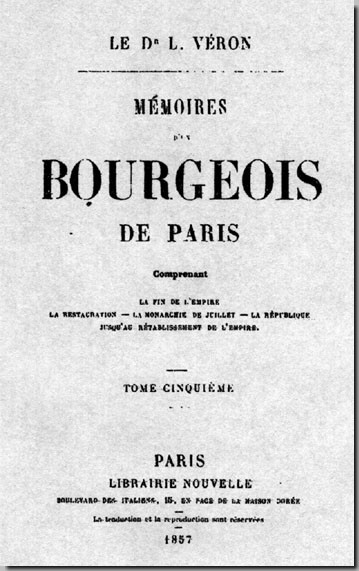
Monsieur le comte de Morny.
(Avant de raconter ce que je sais de particulier et de secret sur tous les événements du 2 décembre, j’ai tenu à faire par anticipation une étude intime de M. le comte de Morny, qui fut appelé à jouer un si grand rôle dans ces événements.)
De tendres et incessants conseils, de sages leçons, de bons exemples, en un mot, l’éducation du foyer, ont surtout le pouvoir de faire tourner à bien, de faire s’épanouir avec bonheur ces rudiments, ces germes héréditaires des goûts, de l’intelligence, des penchants naturels, des entraînements de caractère que le père ou la mère et quelquefois un aïeul transmettent à l’enfant comme défauts, vices ou vertus de famille. On recueille toujours clartés nouvelles et renseignements utiles à tenir compte du milieu dans lequel a d’abord vécu le personnage dont on veut reproduire fidèlement les traits particuliers, l’expression vivante. Prenons donc dès l’âge le plus tendre M. le comte de Morny.
Né le 23 octobre 1811, il fut élevé par sa grand’mère, madame de Souza. Etudions d’abord madame de Souza.
Avant la révolution de 89, madame de Souza était la comtesse de Flahaut. Le comte de Flahaut, beaucoup plus âgé qu’elle, l’avait épousée toute jeune, très agréable, sortant d’un couvent de Paris. Il portait alors les titres de maréchal de camp, d’intendant des jardins et du cabinet du roi ; il logeait au Louvre.
Dans les années qui précédèrent 92, la comtesse de Flahaut recevait la meilleure compagnie ; l’évêque d’Autun (le prince de Talleyrand) tenait souvent chez elle le dé de la conversation. Elle racontait avec charme, dans sa vieillesse, que la politique l’avait toujours ennuyée, et qu’elle s’était de tout temps fait, dans un des coins de son salon, comme une retraite idéale avec son piano, sa harpe et quelques livres. Elle y rêvait sans doute à ces personnages d’élite auxquels elle sut donner la vie dans ses romans. Elle composait alors ce petit chef d’oeuvre, Adèle de Senange, qui ne fut publié qu’en 1794.
La révolution ne pouvait épargner cette famille honorable, ayant charge à la cour et logeant au Louvre : le comte de Flahaut, jeté dans les prisons, périt sur l’échafaud en 1792.
La comtesse, réfugiée d’abord en Angleterre avec son jeune fils, passe bientôt en Suisse. Elle y rencontre, vers 1794, le jeune duc d’Orléans, gagne son amitié et devient la confidente de la brouille du jeune prince avec madame de Genlis.
Elle écrivait de Bremgarten (Suisse) à M Gouverneur Morris, (Mémorial de Gouverneur Morris, homme d’Etat américain, ministre plénipotentiaire des Etas-Unis en France, de 1792 à 1794 : traduit en français ; 2 vol. in-8è, 1842), ministre américain :
« J’ai vu, en Suisse, le jeune duc d’Orléans. Il a eu une qurelle sérieuse avec Mme de Sillery (madame de Genlis), dont il avait tant à se plaindre. Mais ne répétez pas cela ; car si elle savait qu’il en a parlé, elle le persécuterait jusque dans sa retraite. Il est maintenant complètement étranger à cette dame et à ses principes, et il a même retiré sa soeur de ses mains, et l’a confiée à le princesse de Conti, sa tante. »
Il s’est dit de plus à cette époque, que le jeune prince n’avait pas été insensible à la grâce, à l’amabilité de la comtesse de Flahaut, qui, plus âgée que lui, unissait alors à toutes les séductions de l’esprit les charmes non moins sûrs de la seconde jeunesse.
Rentrée en France, madame de Flahaut épouse le comte de Souza Bothello, noble portugais, à qui l’on doit la plus belle édition du Camoëns, publie de gracieux romans, dans lesquels elle peignait, d’une touche très-fine, tantôt les moeurs de l’ancienne société, tantôt celles de l’émigration, associant toujours dans ses oeuvres l’intérêt, une certaine passion et la convenance parfaite de ton et de langage. Madame de Souza avait une charmante manière de dire, l’esprit prompt et l’à-propos. A son retour de l’émigration, elle vit le général Bonaparte. Un jour, celui-ci lui demanda avec une certaine brusquerie : « Eh bien, madame, vous venez d’Allemagne : comment nous traite-t-on là-bas ? on ne nous aime guère ?
– Sire, répondit madame de Souza, on nous aime comme les vieilles femmes aiment les jeunes. »
Madame de Souza montra toujours une fidèle affection pour Madame Bonaparte, après le divorce comme lorsque Joséphine était impératrice.
Bien des femmes, à le fin du dix-huitième siècle et au commencement du dix-neuvième, ont su conquérir, dans la société de leur temps, plus de réputation, faire plus de bruit, exercer un plus grand empire que madame de Souza ; mais aucune, pas même madame de Staël, dans ces jours peu littéraires, ne composa de romans plus dignes d’un succès durable qu’Adèle de Senange et Eugène de Rothelin ; ce sont deux perles qui doivent prendre place à côté de la Princesse de Clèves.
Eugène de Rothelin est le jeune homme accompli tel que le voudraient toutes les mères. On peut penser que madame de Souza, en écrivant ce roman, songeait à son fils et lui proposait un modèle dans ce touchant tableau. Toutefois, lorsque le jeune M de Flahaut entra dans le monde et dans l’armée, il est à croire que sa spirituelle et tendre mère, si au courant des choses de la vie, lui fit surtout confidence, à propos des femmes, de quelques vérités pratiques contrastant peut-être avec les sentiments de ce monde idéal qu’elle se créait. Pour le jeune homme qui entre dans le monde, il y a beaucoup à rabattre du Télémaque !
Le jeune comte de Flahaut, brillant officier, combla tous les voeux de sa mère. C’est certainement à lui qu’elle pensait lorsque, dans Eugénie et Mathilde (1811), elle écrivait :
« Il part pour l’armée ! douleur inexprimable ! inquiétude sans repos ! sans relâche ! inquiétude qui s’attache au coeur et le déchire !… Cependant, si, après sa première campagne, il revient du tumulte des camps, avide de gloire et pourtant satisfait, dans votre paisible demeure ; s’il est encore doux pour vos anciens domestiques, soigneux et gai avec vos vieux amis ; si son regard serein, son sourire encore enfant, sa tendresse attentive et soumise, vous font sentir qu’il se plaît près de vous… ah ! heureuse, heureuse mère ! »
M le comte de Flahaut, remarqué de bonne heure par Napoléon, pour sa bravoure, pour sa jeunesse, pour cette bonne grâce élégante et cette allure décidée qui se ressentaient des deux régimes, de l’ancien et du nouveau, devint bientôt général de division et aide de camp de l’empereur. A la mort de Duroc, en 1813, Napoléon pensa d’abord à M de Flahaut pour le nommer grand maréchal du palais. C’était le temps où l’empereur pensait aussi à M Molé, ministre de la justice, jeune et du meilleur monde, pour remplacer Cambacérès, qui se faisait vieux, scrupuleux et dévot. Un peu de faveur, dont témoignait une si rapide élévation, se justifiait de reste par les qualités brillantes de ces deux hommes distingués, qui, dans l’ordre civil comme dans l’armée, ne dataient que de l’empire, et que Napoléon pouvait se vanter d’avoir seul formés.
Madame de Souza, veuve une seconde fois, ne mourut qu’en 1836 (M le comte de Morny comptait alors vingt-cinq ans). Depuis 1811, l’auteur d’Adèle de Senange ne cessa d’entourer du plus tendre et du plus vif intérêt l’avenir d’un jeune homme qui chaque année prenait de plus en plus, auprès d’elle, cete bonne grâce, cette élégance fine de manières alors déjà perdues et oubliées. M de Morny, à son tour, était devenu l’Eugène de Rothelin de la vieillesse de madame de Souza.
Admis très-jeune dans un monde sérieux, aimable et lettré, il faisait de bonne heure, avec une spirituelle facilité, beaucoup de pièces de vers qu’il n’eut jamais la pensée de publier ; il composait plus tard des romances, paroles et musiques, que dans l’intimité il chantait d’une voix de ténor timbrée et légère ; enfin il montrait ces mêmes penchants d’esprit auxquels s’abandonnait madame de Souza dans cette retraite idéale d’un des coins de son salon.
Cependant le jeune de Morny, bientôt mis en pension chez M Muron, y suit les classes du collège Bourbon ; il reçoit de M Casimir Bonjour des leçons particulières de grec ; il apprend l’anglais, qu’il parle et prononce aujourd’hui comme un membre de la chambre des lords.
On conduisait assez souvent l’élégant élève du collège Bourbon en visite chez le prince de Talleyrand, qui prenait plaisir à le faire causer. Un jour, M de Talleyrand dit à M Martin, gouverneur des enfants de M de Dino : « N’avez-vous pas rencontré dans l’escalier un petit bonhomme que M de Flahaut tenait par la main ? – Oui, prince. – Eh bien, souvenez-vous de ce que je vais vous dire : cet enfant-là sera un jour ministre. » M de Morny avait alors douze ans.
Le futur ministre sortait de l’école d’état-major en 1832, à vingt et un ans, pour entrer, comme sous-lieutenant, dans le 1er régiment de lanciers. M de Morny, en garnison à Fontainebleau, eut facilement de M le comte de Montalivet l’autorisation de fréquenter la bibliothèque de cette résidence royale. A ce sujet, madame de Souza disait un jour à un de ces amis (M de Sainte-Beuve) en lui montrant le portrait de son petit-fils qu’elle avait sous les yeux : « Vous voyez bien ce jeune homme dont l’avenir me préoccupe et m’intéresse : quels livres croyez-vous qu’il choisisse pour ses lectures ? Vous pensez qu’il lit des romans, des poésies légères, des mémoires agréables, des Contes de Voltaire : à tout cela, il préfère des livres de métaphysique, de théologie. Et savez-vous la raison qu’il m’en donne ? – J’étudie d’abord les livres de religion, dit-il, parce que je veux tout de suite couler à fond cette question-là. »
Ces études ne firent pas que le sous-lieutenant de lanciers entrât au séminaire ; mais il sollicita et obtint la faveur de partir pour l’armée d’Afrique. Il prit part à l’expédition de Mascara et au siège de Constantine.
A Mascara, officier d’ordonnance du général Oudinot, il traverse avec le capitaine Adolphe de Caraman toute l’armée d’Abd-el-Kader pour rejoindre l’avant-garde de l’armée française.
p.180
… Grâce à tout cela, et même aux conseils pratiques de madame de Souza, qui savait si bien le train du monde et les tressaillements les plus cachés du coeur humain, M le comte de Morny entre par l’industrie dans la politique, et monte sur un nouveau théâtre sans timidité comme sans présomption.
D’une gravité sympathique, d’une politesse digne, froide, mais qui ne va pas jusqu’au dédain, M de Morny s’est en tout temps fait remarquer par une certaine surveillance de sa vie, par une certaine économie de soi-même. Dans toute compagnie, il montre de l’aisance, du naturel ; mais il ne fréquente guère que ce qu’on est convenu d’appeler le grand monde. C’est là son milieu ; il y prit ses lettres de naturalisation dès le salon de madame de Souza. Il est là tout à l’aise, il y a ses coudées franches ; il s’y fait surtout remarquer par son langage…
p.257 (coup d’état du 2 décembre 1851 – Elysée)
… Le président de la république était accompagné de ses aides de camp et officiers d’ordonnance, de MM Fleury et Edgar Ney, du général Roguet, du lieutenant-colonel Béville, du capitaine Lepic, des généraux Vast-Vimeux, le Pays de Bourjolly, Flahaut, du colonel Murat, etc… le roi Jérôme était à ses côtés…
p.261 (coup d’état du 2 décembre 1851 – Ministère de l’Intérieur)
M de Morny, réveillé dès cinq heures du matin, se rend à six heures au ministère de l’intérieur. Il était accompagné de M le comte de Flahaut, de M Léopold Lehon et d’un secrétaire. Ces messieurs n’étaient suivis que d’un seul domestique. Le bataillon de service pendant la nuit à l’Assemblée nationale avait déjà été relevé ; en passant devant la Chambre pour se rendre rue de Grenelle, malgré l’obscurité, M de Morny put le constater…
